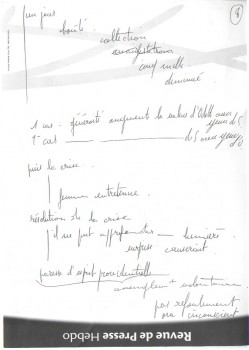Nous voilà donc reconduits à ces célèbres Vertus et Vices. Les allégories de Giotto constitue un passage obligé vu le sujet de mon cours, peut-être même en sont-elle l'entrée intévitable et peut-être êtes-vous surpris qu'on ne les aie pas vues plus tôt.
Nous avons vu la semaine dernière que les Vertus ne sont pas plus belles que les Vices. Je voudrais comparer ces allégories avec un roman allégorique, par exemple Manon Lescaut.
Antoine Compagnon projette une image : Vous oyez ici la vignette gravée par Pasquier pour illustrer l'édition de 1753 de Manon Lescaut.

Vous apercevez peut-être ce vers d'Horace en exergue: Quanta laborabas Charybdi, digne puer meliore flamma!, c'est-à-dire «Quel tourment n'endures-tu pas, digne d'un plus noble amour». Dans les premiers paragraphes, l'auteur avertit ainsi ses lecteurs:
Outre le plaisir d'une lecture agréable, on y trouvera peu d'événements qui ne puissent servir à l'instruction des mœurs ; et c'est rendre, à mon avis, un service considérable au public, que de l'instruire en l'amusant. (texte intégral).
La vignette représente des Grieux en Télémaque et Pallas en Mentor. Calipso, ou la nymphe Eucharis, représente la faiblesse de l'homme face à l'amour charnel sans le secours de la grâce divine. L'amour sacré est représenté par Tiberge, c'est-à-dire ici l'amitié. Le plus noble amour, c'est la vertu, c'est pour cela qu'il s'agit d'un roman allégorique.
Le narrateur de La Recherche en est conscient. Il fait référence à Manon à plusieurs reprises.
Au moment du départ d'Albertine:
J’entendis à l’étage au-dessus du nôtre des airs joués par une voisine. J’appliquais leurs paroles que je connaissais à Albertine et à moi et je fus rempli d’un sentiment si profond que je me mis à pleurer. C’était:
Hélas, l’oiseau qui fuit ce qu’il croit l’esclavage,
Le plus souvent la nuit
D’un vol désespéré revient battre au vitrage
et la mort de Manon:
Manon, réponds-moi donc, seul amour de mon âme,
Je n’ai su qu’aujourd’hui la bonté de ton cœur.
Puisque Manon revenait à Des Grieux, il me semblait que j’étais pour Albertine le seul amour de sa vie. Hélas, il est probable que si elle avait entendu en ce moment le même air, ce n’eût pas été moi qu’elle eût chéri sous le nom de Des Grieux, [...] [1]
Les situations sont donc comparées, mais le narrateur refuse la lecture allégorique qu'annonce la mort d'Albertine. Et pourtant, une lecture allégorique de La Recherche est bien possible, avec l'opposition de la créature/la création, l'amour sacrée/l'amour charnelle, l'échec de Swann qui choisira l'amour charnel/le succès du narrateur qui choisira l'art.
Comme souvent dans les allégories, une femme doit mourir pour qu'un homme se réalise.
A propos du septuor de Vinteuil, on trouve ces remarques:
Au reste, le contraste apparent, cette union profonde entre le génie (le talent aussi et même la vertu) et la gaine de vices où, comme il était arrivé pour Vinteuil, il est si fréquemment contenu, conservé, étaient lisibles, comme en une vulgaire allégorie, dans la réunion même des invités au milieu desquels je me retrouvai quand la musique fut finie.[2]
La «gaine de vices», c'est le salon des Verdurins. Cela rappelle le début de Gargantua, «l'habit ne fait pas le moine», l'opposition classique de la gangue et du trésor. Mais pour le narrateur, toute allégorie est vulgaire.
Je reviens aux Vices et Vertus en vous les montrant. Les qualités morales n'ont pas de valeur esthétique, ce sera la grande leçon: l'esthétique est indépendante de l'éthique, ce sera la grande leçon que le narrateur retiendra de ces Vices et Vertus.
Malgré toute l’admiration que M. Swann professait pour ces figures de Giotto, je n’eus longtemps aucun plaisir à considérer dans notre salle d’études, où on avait accroché les copies qu’il m’en avait rapportées,
cette Charité sans charité, cette Envie qui avait l’air d’une planche illustrant seulement dans un livre de médecine la compression de la glotte ou de la luette par une tumeur de la langue ou par l’introduction de l’instrument de l’opérateur, une Justice, dont le visage grisâtre et mesquinement régulier était celui-là même qui, à Combray, caractérisait certaines jolies bourgeoises pieuses et sèches que je voyais à la messe et dont plusieurs étaient enrôlées d’avance dans les milices de réserve de l’Injustice. [3]
Il n'y a pas de différence. L'injustice de Giotto ne présente aucune émotion (Antoine Compagnon nous la montre et la commente): vous voyez à ses pieds le vol, le viol et le meutre, présentés sans trace de souffrance, la Justice est tout aussi insensible.
Les fresques de Giotto illustrent la vie de la Vierge, elles représentent dans un bandeau les sept vertus et les sept vices. Les vertus sont les trois vertus théologales, foi, espérances, charité, et les quatre vertus cardinales, prudence, tempérance, force et justice. Elles se présentent deux à deux, la Folie avec la Force, la Tempérance avec la Colère. Au centre se trouvent la Justice et l'Injustice. On trouve également la Foi et l'Infidélité, que Proust appelle Idolâtrie, et qui tient à la main une idole. Elle servira à décrire Albertine un matin à Balbec:
Un des matins qui suivirent celui où Andrée m’avait dit qu’elle était obligée de rester auprès de sa mère, je faisais quelques pas avec Albertine que j’avais aperçue, élevant au bout d’un cordonnet un attribut bizarre qui la faisait ressembler à l’« Idolâtrie » de Giotto ; il s’appelle d’ailleurs un « diabolo » et est tellement tombé en désuétude que devant le portrait d’une jeune fille en tenant un, les commentateurs de l’avenir pourront disserter comme devant telle figure allégorique de l’Aréna, sur ce qu’elle a dans la main. [4]
Comme souvent, Proust trivialise l'objet. L'idole devient un diabolo.
La Charité s'oppose à l'Envie et l'Espérance au Désespoir, représentée par le suicide.
Ici Compagnon sourit: Sept vertus et sept vices, j'aurais pu les prendre une à une, cela faisait à peu près mes treize leçons. Si je ne l'ai pas fait, c'est qu'on trouve partout un mélange de vertu et de méchanceté. Chacun est à la fois le mal et le remède. Odette pour Swann, par exemple, c'est à la fois «cette Odette sur le visage de qui il avait vu passer les mêmes sentiments de pitié pour un malheureux, de révolte contre une injustice, de gratitude pour un bienfait, qu’il avait vu éprouver autrefois par sa propre mère» [5], et une femme entretenue qui le fait souffrir.
De même, quand le narrateur finit par rejoindre sa mère après l'épisode d' O Sole mio que nous avons vu, celle-ci lui dit (enfin, c'est le texte de la vieille Pléiade, dans la nouvelle, c'est une variante en commentaire):
«Tu sais, dit-elle, ta pauvre grand'mère le disait: C'est curieux, il n'y a personne qui puisse être plus insupportable ou plus gentil que ce petit-là.» Nous vîmes sur le parcours Padoue puis Vérone [...] [6]
On voit que le narrateur note cette cohabitation du vice et de la vertu, et qu'il passe aussitôt à un autre sujet. Il se refuse à théoriser.
Tout cela nous ramène à Montaigne. Dans le chapitre sur les cannibales, il évoque nos fautes ordinaires:
Et les médecins ne craignent pas de s'en servir à toute sorte d'usage, pour notre santé; soit pour l'appliquer au dedans, ou au dehors. Mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui excusât la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires. [7]
(On voit ici que Montaigne croit encore aux vertus guérissantes des cadavres, en particulier des remèdes tirés des momies).
Dans le chapitre De l'utile et de l'honnête, Montaigne évoque les offices malhonnêtes accomplis au nom de la raison d'Etat. Il établit un parallèle entre les vices au niveau social et les vices au niveau individuel:
Notre être est cimenté de qualités maladives; l'ambition, la jalousie, l'envie, la vengeance, la superstition, le désespoir logent en nous d'une si naturelle possession que l'image s'en reconnaît aussi aux bêtes; voire et la cruauté, vice si dénaturé;
Le vice appartient à la nature, ou du moins nous le croyons et le ressentons ainsi, même à propos de la cruauté, qui échappe pourtant à la nature: car, au milieu de la compassion, nous sentons je ne sais quelle aigre-douce pointe de volupté maligne à voir souffrir autrui; et les enfants le sentent;
Toute compassion est impure et mêlée de plaisir, Montaigne reprend ici des vers de Lucrèce de De rerum natura:
Suave mari magno turbantibus æquora ventis,
E terra magnum alterius spectare laborem.
«Il est doux, quand sur la vaste mer les vents soulèvent les flots, d'apercevoir du rivage les périls d'autrui.»
Il n'y a pas de vie sans vice. Pour Proust, la pire des cruautés est celle de l'indifférence.
On découvre ici le trope de l'aigre-doux. Il y a un certain plaisir à voir souffrir autrui. Il n'existe pas de compassion sans plaisir.
Les deux premiers vers de Lucrèce pris hors contexte peuvent donner lieu à des accusations d'égoïsme, et Lucrèce l'a prévenu dès les deux vers suivants:
Non quia vexari quemquamst iucunda voluptas,
Sed quibus ipse malis careas quia cernere suavest.
«non que la souffrance de personne soit un plaisir si grand; mais il est doux de voir à quels maux on échappe soi-même.»: l'ataraxie du sage est mêlée d'un peu d'inhumanité.
La Recherche regorge d'exemples d'ataraxie, on songe par exemple à l'apparition de Swann malade entrant dans le salon de la princesse de Guermantes. Le narrateur regarde les invités regarder Swann, avec
cette espèce de fascination qu’exercent les formes inattendues et singulières d’une mort prochaine, d’une mort qu’on a déjà, comme dit le peuple, sur le visage.
Cette expression reviendra à la fin de La Recherche, au moment où la Berma, mourante, sera abandonnée de tous, même de sa fille: là aussi, la Berma portera la mort sur son visage. Swann mourra bientôt, c'est visible par le fait que le type juif fait retour sous le chic anglais.
Et c’est avec une stupéfaction presque désobligeante, où il entrait de la curiosité indiscrète, de la cruauté, un retour à la fois quiet et soucieux (mélange à la fois de suave mari magno et de memento quia pulvis, eût dit Robert), que tous les regards s’attachèrent à ce visage duquel la maladie avait si bien rongé les joues, comme une lune décroissante, que, sauf sous un certain angle, celui sans doute sous lequel Swann se regardait, elles tournaient court comme un décor inconsistant auquel une illusion d’optique peut seule ajouter l’apparence de l’épaisseur.[8]
C'est une phrase compliquée comme il arrive chaque fois que Proust cherche à saisir un sentiment impur, alliance de curiosité indiscète, de cruauté et d'égotisme (retour sur soi-même), un sentiment «quiet», c'est-à-dire sans souci, et «soucieux» à la fois. On voit cité memento quia pulvis, «Souviens-toi que tu es poussière». Cette citation des pages roses du dictionnaire est attribuée à Saint-Loup, la parenthèse cherche à saisir la contradiction. Si le narrateur cite Saint-Loup, c'est peut-être pour marquer sa distance.
L'égoïsme est rattrapé au dernier moment par la vanité. Memento quia pulvis es, et in pulverem reverteris, «Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière.» C'est la phrase de la Genèse que prononce le prêtre le jour des Cendres.
Proust est très sensible au thème de la tempête observée en toute sécurité du rivage. Cette métaphore annonce le bal des têtes. Le narrateur a vieilli mais moins que les autres personnages. Il les voit et les décrit, par exemple le duc de Guermantes:
Il n’était plus qu’une ruine, mais superbe, et plus encore qu’une ruine, cette belle chose romantique que peut être un rocher dans la tempête. Fouettée de toutes parts par les vagues de souffrance, de colère de souffrir, d’avancée montante de la mer qui la circonvenaient, sa figure, effritée comme un bloc, gardait le style, la cambrure que j’avais toujours admirés ; [suit une longue métaphore filée] elle était rongée les mèches blanches de sa chevelure moins épaisse venaient souffleter de leur écume le promontoire envahi du visage.[9]
Une autre occurence du suave mari magno, mais plus froide, sans l'adoucissement du memento mori, se retrouve dans l'évocation des planqués, ceux de l'arrière, lors de la guerre: Charlus poursuit ses plaisirs, les Verdurin poursuivent leur salon, et pourtant, cela ne les empêche pas de s'intéresser aux événements du front.
Ils pensaient, en effet, à ces hécatombes de régiments anéantis, de passagers engloutis, mais une opération inverse multiplie à tel point ce qui concerne notre bien être et divise par un chiffre tellement formidable ce qui ne le concerne pas, que la mort de millions d’inconnus nous chatouille à peine et presque moins désagréablement qu’un courant d’air.
La mort perd dans l'anonymat et le multiple sa dimension d'avertissement. La dimension maritime des «passagers engloutis» me fait penser au Suave mari magno.
Mme Verdurin, souffrant pour ses migraines de ne plus avoir de croissant à tremper dans son café au lait, avait obtenu de Cottard une ordonnance qui lui permettait de s’en faire faire dans certain restaurant dont nous avons parlé. Cela avait été presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs publics que la nomination d’un général. Elle reprit son premier croissant le matin où les journaux narraient le naufrage du Lusitania. Tout en trempant le croissant dans le café au lait et donnant des pichenettes à son journal pour qu’il pût se tenir grand ouvert sans qu’elle eût besoin de détourner son autre main des trempettes, elle disait: « Quelle horreur! Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies. » Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième, car tout en faisant, la bouche pleine, ces réflexions désolées, l’air qui surnageait sur sa figure, amené probablement là par la saveur du croissant, si précieux contre la migraine, était plutôt celui d’une douce satisfaction.[10]
Toute la scène est marine, cela se retrouve jusque sur le visage de Mme Verdurin, avec «surnageait».
Le journal présente une variante moderne du Suave mari magno, étendu au quotidien. Françoise, qui est sans doute le personnage le plus ambivalent de La Recherche, est une grande lectrice de journaux. On retrouve ce trait lors des promenades aux Champs-Elysées, là encore associé à la tempête:
les jours de tempête, quand le vent était si fort que Françoise en me menant aux Champs-Élysées me recommandait de ne pas marcher trop près des murs pour ne pas recevoir de tuiles sur la tête, et parlait en gémissant des grands sinistres et naufrages annoncés par les journaux.[11]
Cette idée avait déjà été émise par Baudelaire dans Mon cœur mis à nu.
Il est impossible de parcourir une gazette quelconque, de n'importe quel jour, ou quel mois, ou quelle année, sans y trouver, à chaque ligne, les signes de la perversité humaine la plus épouvantable, en même temps que les vanteries les plus surprenantes de probité, de bonté, de charité, et les affirmations les plus effrontées, relatives au progrès et à la civilisation.
Tout journal, de la première ligne à la dernière, n'est qu'un tissu d'horreurs. Guerres, crimes, vols, impudicités, tortures, crimes des princes, crimes des nations, crimes des particuliers, une ivresse d'atrocité universelle.
Et c'est de ce dégoûtant apéritif que l'homme civilisé accompagne son repas de chaque matin. Tout, en ce monde, sue le crime : le journal, la muraille et le visage de l'homme.
Je ne comprends pas qu'une main puisse toucher un journal sans une convulsion de dégoût.
Quelle est la moralité de celui qui lit le journal tous les jours? Le thème du journal est très présent: Morel lit le journal quand l'article du narrateur paraît dans Le Figaro. Le journal est comparé à la multiplication des pains:
Puis je considérai le pain spirituel qu’est un journal encore chaud et humide de la presse récente dans le brouillard du matin où on le distribue, dès l’aurore, aux bonnes qui l’apportent à leur maître avec le café au lait, pain miraculeux, multipliable, qui est à la fois un et dix mille, qui reste le même pour chacun tout en pénétrant innombrable, à la fois dans toutes les maisons.[12]
Il y a là une part de parodie, le journal est assimilé au Notre Père.
Mais en général, le journal dans La Recherche est plutôt associé au bas du corps. Par exemple, quand la responsable des cabinets des Champs-Elysées parle de l'un de ces meilleurs clients:
[...] tous les jours que Dieu a faits, sur le coup de 3 heures, il est ici, toujours poli, jamais un mot plus haut que l’autre, ne salissant jamais rien, il reste plus d’une demi-heure pour lire ses journaux en faisant ses petits besoins.[13]
Dans la scène de Mme Verdurin mangeant son croissant, nombreux sont les mots qui évoque le Suave mari magno: naufrage, noyés, douce satisfaction, contraste entre la sécurité de la lectrice à table et la mort des passagers dans la tempête.
Suave mari magno: c'est cela la forme de la cruauté dans La Recherche. C'est un alliage de commisération et d'indifférence, une marque d'insensibilité. En allemand, cesentiment qu'on peut éprouver devant la souffrance de l'autre s'appelle Shadenfreude. En français, il manque un mot. Ce n'est pas l'envie, car l'envie, c'est soit la souffrance devnat le bonheur d'autrui, soit la pointe de bonheur devant le malheur d'autrui.
Il existe bien un mot, mais il est cuistre, c'est un mot ancien tombé du dictionnaire: l'épicaricatie. Ce mot a disparu des dictionnaires au XVIIe siècle. "épi": sur, "cari": joie, "catie": mal. L'épicaricatie se rapproche de la délectation morose, qui est une pensée mauvaise qui donne du plaisir. C'est plutôt un memento mori' sans le suave mari magno''.
On en trouve de nombreux exemples chez Bloch. Bloch ressent les deux formes d'envie.
L'épicaricatie apparaît dès le début de La Recherche, mais sous des formes plus graves. L'une des premières scènes présente le supplice de la grand-mère et la lâcheté de la famille. Ce n'est plus tout à fait le suave mari magno, qui est aussi une forme d'impuissance devant l'inélectulable: on ne peut rien faire. Dans la scène suppliciant la grand-mère, il serait possible d'intervenir, mais c'est interdit socialement. Selon le sociologue Gabriel de Tarde, il s'agit de la loi de l'imitation. La grand-mère joue le rôle du bouc émissaire que la grand-tante prend plaisir à tourmenter. La grand-mère est étrangère au groupe, elle est l'autre.Le groupe est ligué contre elle.
Pour la taquiner, en effet (elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde la plaisantait et la tourmentait), comme les liqueurs étaient défendues à mon grand-père, ma grand’tante lui en faisait boire quelques gouttes. Ma pauvre grand’mère entrait, priait ardemment son mari de ne pas goûter au cognac ; il se fâchait, buvait tout de même sa gorgée, et ma grand'mère repartait, triste, découragée, souriante pourtant, car elle était si humble de cœur et si douce que sa tendresse pour les autres et le peu de cas qu’elle faisait de sa propre personne et de ses souffrances, se conciliaient dans son regard en un sourire où, contrairement à ce qu’on voit dans le visage de beaucoup d’humains, il n’y avait d’ironie que pour elle-même, et pour nous tous comme un baiser de ses yeux qui ne pouvaient voir ceux qu’elle chérissait sans les caresser passionnément du regard.
C'est la première découverte du mal, elle a lieu dans le cercle familial. C'est une forme de lâcheté.
Ce supplice que lui infligeait ma grand’tante, le spectacle des vaines prières de ma grand’mère et de sa faiblesse, vaincue d’avance, essayant inutilement d’ôter à mon grand-père le verre à liqueur, c’était de ces choses à la vue desquelles on s’habitue plus tard jusqu’à les considérer en riant et à prendre le parti du persécuteur assez résolument et gaiement pour se persuader à soi-même qu’il ne s’agit pas de persécution; elles me causaient alors une telle horreur, que j’aurais aimé battre ma grand’tante. Mais dès que j’entendais: «Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac!» déjà homme par la lâcheté, je faisais ce que nous faisons tous, une fois que nous sommes grands, quand il y a devant nous des souffrances et des injustices: je ne voulais pas les voir; je montais sangloter tout en haut de la maison à côté de la salle d’études, sous les toits, dans une petite pièce sentant l’iris, [...] [14]
Il s'agit d'un passage initiatique, l'apprentissage de la lâcheté universelle face à la souffrance de l'autre. C'est l'envers du suave mari magno qui est un cas où l'on voit la souffrance sans pouvoir intervenir: dans le cas de la lâcheté sociale, on pourrait intervenir mais on refuse de voir.
Là encore, on trouve des exemples autour de Françoise qui est un parangon de la torture. Toutes les couleurs morales sont réunies chez Françoise. Il s'agit d'un prélude à la scène de la torture de la fille de cuisine. Le narrateur vient de voir comment Françoise mettait à mort les animaux qu'elle cuisinait:
Je remontai tout tremblant; j’aurais voulu qu’on mît Françoise tout de suite à la porte. Mais qui m’eût fait des boules aussi chaudes, du café aussi parfumé, et même... ces poulets ?... Et en réalité, ce lâche calcul, tout le monde avait eu à le faire comme moi. Car ma tante Léonie savait — ce que j’ignorais encore — que Françoise qui, pour sa fille, pour ses neveux, aurait donné sa vie sans une plainte, était pour d’autres êtres d’une dureté singulière. Malgré cela ma tante l’avait gardée, car si elle connaissait sa cruauté, elle appréciait son service. [15]
Tout le monde est coupable. Tout le monde fait preuve de douceur pour les siens et de dureté pour les autres. Il s'agit d'une morale fermée, qui ne s'étend pas à l'universel. C'est l'exacte contraire de la charité selon Bergson. La loyauté se définit par la solidarité avec les proches, la charité par la solidarité avec le genre humain.
la version de sejan